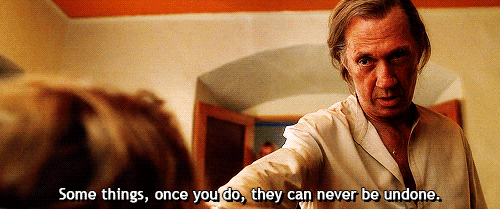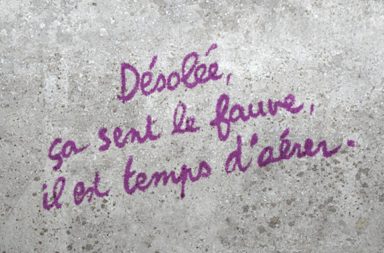Certain-e-s ont crié au génie, continuent à le faire et le feront certainement pour la sortie prochaine de son huitième film, Les Huit Salopards. Huit sur dix si l’on en croit les dires de Quentin Tarantino, qui a d’ores et déjà annoncé sa fin de carrière. Amplement plébiscité pour chacune de ses productions, le réalisateur mérite-t-il pour autant toutes les louanges faites autour de ses connaissances, de sa précision ou encore de son militantisme cinématographique ?
Quentin Tarantino a remporté de nombreux succès, à la fois critiques et publics. Triomphe populaire, mais aussi reconnaissance d’une patte dite d’auteur, il divise autant qu’il rassemble. Venant du circuit indépendant et continuant à y être rattaché, il a enchaîné des productions toujours plus ambitieuses, restant cependant précis, exigeant et libre des carcans des majors.
Dans les films de Tarantino, les contraires s’entrechoquent cultivent l’ambiguïté entourant le réalisateur. Voulant à la fois se faire plaisir et « travailler sur les sous-genres [sans en suivre] les codes à la lettre », il tient à communiquer ce même plaisir à tous. Il exulte autant à marcher dans les pas de ses prédécesseurs-ses qu’à amener un genre à son apogée. Certaines fois orfèvre du cinéma, d’autres entertainer, il est cependant loin de faire l’unanimité, notamment lorsqu’il est question de thématiques telles que le féminisme ou le racisme.
Se tenir sur le fil du rasoir semble d’ailleurs être devenu une spécialité que Tarantino a su affiner avec le temps. Susciter le débat, c’est presque un objectif. Il affirme rendre hommage au septième art et a su délivrer des productions emplies de références et de renvois intertextuels. Salué comme cinéphile aguerri, il n’échappe pas au sein du même mouvement à des accusations répétées de plagiat sur ses productions, de la toute première à Kill Bill en 2003. Plus que cinéphile, il en est ainsi venu à être qualifié de fétichiste du cinéma. De ce dernier, mais aussi des femmes ou encore de la violence. Un fétichiste dont les hommages sont vus comme un peu trop fidèles, cinématographiquement parlant, plus approximatifs pour ce qui est du reste.
La façade polie d’un édifice bancal
Depuis Reservoir Dogs (1992), le style Tarantino a bien évolué. En proposant des revenge movies1, une « trilogie de l’oppression » et son approche – jouissive selon beaucoup – de certaines libertés bafouées, il a pour mérite indéniable d’attirer l’attention sur ces thématiques. Voir et revoir, lire et relire ses bobines et scénarios met ainsi en lumière des sujets de plus en plus discutés. Cependant, des voix s’élèvent pointant le caractère oppressif que ses images paraissent vouloir dénoncer. Il les renforcerait de la pire manière qui soit, le cas échéant, sous couvert de les contester et donc brouillant les cartes sur les véritables messages des mouvements concernés.
Racisme, sexisme, violence, blaxploitation… Il manierait avec l’adresse d’un Johnny Depp sous éther ou, plus récemment, d’un Dicaprio sous quaalude, des problématiques lourdes de conséquences. Construire des personnages féminins défendant difficilement les féministes reste un des exemples les plus flagrants de l’insouciance de l’approche tarantinesque. Il en va de même des débats autour de Django Unchained (2012) et de sa description discutable et discutée de l’esclavagisme et du racisme.
Jouissifs, les films du sulfureux Tarantino le demeurent pour autant, on ne peut lui enlever cela. On ressort de la salle galvanisé par le massacre en règle de toutes les personnes qui ont été du mauvais côté de l’histoire. C’est entre autres ce qu’a pu dire Lawrence Bender, producteur de l’uchronie Inglourious Basterds (2009) annonçant poétiquement que le réalisateur avait offert « un putain de rêve [aux] juifs-ves ».
Le cinéaste sait mieux que personne faire monter la pression jusqu’à l’exutoire final. La frustration contenue tout du long est alors relâchée, les hormones bouillonnent à peu près autant que le cerveau d’un adolescent sous boisson énergisante contraint de jouer à Pop’n music, une lumière stroboscopique dans les yeux. Mais passé ce vernis, le divertissement représente-t-il une fin en soi ? Un passe-droit ? Tarantino propose des imaginaires traitant de sujets sensibles, provocants. Les êtres y sont clivant-e-s, et l’on peut parfois douter de leur humanité.
Certaines critiques prennent alors pour cible la violence exagérée des productions elles-mêmes, menant leurs propres luttes à l’encontre de cette intensité débridée. Mais les plus solides réserves avancées ne sont pas au sujet des héroïnes fortes – encore trop rares sur grand écran –, des flots de sang ou de tel ou tel détail de plan, mais bien des maladresses ou contre-emplois de concepts faisant souvent s’effondrer beaucoup les velléités militantes des productions. S’ils devaient être une tapisserie, ce n’est en somme pas le fil utilisé dans la fabrique de ces films qui pose problème, mais bien le tissage simpliste qui bloque la création de motifs complexes. Complexité dont des problématiques telles que le sexisme ou le racisme ne peuvent se passer.
Alors, ambition justifiée de la part du cinéaste ou gourmandise de la part du réalisateur ? Déranger suffit-il à simplement pallier toutes les imprécisions et absences ?
L’écran de fumée des rôles féminins
Entrant plus amplement dans la mécanique des revenge movies avec les fameux Kill Bill, les films estampillés Tarantino ont opéré un tournant des engagements politiques tant dans sa représentation que dans ses fétichismes. Ils constituent un point d’entrée parfait dans cet univers de l’à peu près.
Cas numéro 1 : Kill Bill
C’est dans ce film duel ayant marqué les esprits, qu’une femme forte (Uma Thurman) cherche à venger le meurtre de son mari et de son enfant à naître en tranchant tout ce qu’elle rencontre à coups de katana, le tout dans un costume emprunté à feu Bruce Lee. Indéniablement physiquement puissante, Béatrix Kiddo l’est, tout autant que les femmes assassines du Deadly Viper Assassination Squad dont elle faisait partie. Elle les affronte une à une, qu’elles soient devenues mère de famille, loup solitaire ou PDG psychotique d’une florissante triade. Elle affronte également un homme, un cercueil, et enfin le fameux Bill (David Carradine), son ex, mais aussi père de son enfant et chef dictatorial de cette équipe de feu.
Il n’y a donc pas de doute pour une large partie du public recevant ces quatre et quelques heures de films : ils sont féministes et se jouent du patriarcat, allant jusqu’à lui régler son compte en guise de grand final. Mais en s’intéressant aux productions une fois le rush d’adrénaline passé, force est de constater qu’elles promeuvent un message, au mieux, très vague, au pire, perverti du féminisme.
Certes, Uma Thurman est souvent filmée en contre-plongée, mise en avant, ne craint rien et endosse violence et attributs usuellement réservés au masculin. Bien sûr les hommes se font découper menu à grand renfort d’hémoglobine et sont ponctuellement anonymisés derrière des masques, perdant jusqu’à leur identité. Bill, figure masculine majeure du film, joue au fantôme laissant ainsi le champ libre aux femmes du casting. Son frère Buck (Michael Bowen), également, n’affronte pas directement Béatrix Kiddo et est rapidement évincé. Mais cela reste une première lecture, lors de laquelle on ignore bien trop d’éléments.
Lors d’un second passage, rien n’est aussi plein et évident. Majoritairement éprise de la vengeance qui lui sert de carburant, l’héroïne détruite devient action et non plus discours. Femme à la psychologie unidimensionnelle pendant la majorité de l’œuvre, elle revient à la parole plus volubile une fois son enfant retrouvée, se tournant complètement vers elle et brisant les enchaînements de combats. Antérieurement, elle n’éprouve aucun sentiment hormis la colère, semble-t-il, et reste insensible au fait de tuer sa première adversaire (Vernita Green) sous les yeux de la fille de celle-ci. Elle est ensuite ramenée toujours davantage, à mesure que la pellicule se déroule, vers ce qui apparaît être son horizon d’attente, une maternité à la fois source et aboutissement de sa quête. La conclusion des films est une sorte de contrebalance de la violence par la douceur maternelle, que l’on peut facilement interpréter comme un « retour à la normale », un négatif de ce qui a émaillé toute l’œuvre. D’une machine à tuer, elle redevient mère.
En parallèle, Bill, grand marionnettiste, est certes physiquement absent, mais reste le MacGuffin omniprésent, la grande force qui plane et ordonne à ses subordonnées de tuer son ex-femme. Toutes s’affrontent dans son ombre, et ce pour l’atteindre d’une manière ou d’une autre. On peut d’ailleurs y reconnaître un écho du schéma de la série Drôles de Dames (1976) qui fut autant saluée pour ses personnages féminins forts que critiquée pour son sexisme. Représentations d’un patriarcat à la mode Big Brother, la mort finale de Bill – prédite dans le titre – passe presque inaperçue au regard de la mise en avant de sa fibre paternelle ou de son rôle durant les centaines de minutes précédentes.
Enfin, et davantage révélateur : Béatrix est mise en position de force physique, de violence incarnée, mais n’a que peu d’épaisseur en tant que personnage. Elle devient un pantomime de l’agressivité ordinairement masculine. Vidée de toute substance supplémentaire, ne sachant répondre que par le sang à tout traumatisme, elle est l’illustration d’une figure que Tarantino a employé régulièrement : la guerrière sexy. À cet archétype, il adjoint une figure qui sera encore plus identifiable dans Boulevard de la mort (2007) : la phallic girl. Ces deux notions, étudiées à la fois par Angela McRobbie2 et Maxime Cervulle3, dévoilent le vrai visage de Béatrix Kiddo, réceptacle de comportements clichés, traditionnellement masculins. S’insérant au cœur d’une féminité plus classique, la phallic girl dépolitise et décontextualise, par son approche simpliste et sa transposition pure et dure de clichés, d’un genre sexué à l’autre. Le personnage de Béatrix est donc creux et souffre cruellement d’un manque d’épaisseur en tant que figure supposément féministe. Le film a ainsi toutes les apparences d’un combat qu’il ne mène que ponctuellement, voire qu’il nie par l’usage de clichés, sans historicité aucune.

On peut compléter cette liste non exhaustive d’aspects problématiques avec l’inclusion de l’archétype de la femme fatale issue du film noir en la personne d’Elle Driver (Daryl Hannah), hautement dépendante de l’appréciation de Bill. Archétype basé sur une image d’hyperféminité dangereuse, empoisonnée, véritable problème à résoudre et à faire entrer dans le moule traditionnel (ou à éliminer). Sans oublier un énième usage, ici ponctuel mais pas moins navrant, du rape and revenge (« viol et vengeance », en français). Ce sous-genre, employé ad nauseam depuis les années 1970, utilise comme élément déclencheur un viol, cause d’une vengeance ou d’une intrigue – pour y ajouter le « piment » d’une violence sexualisée – et ne prend pas en compte les réalités d’un tel trauma, ses conséquences et les véritables réactions que peuvent avoir des victimes à un tel événement. Fiction écrite par des hommes et pour des hommes, il ne s’agit que d’une facilité d’écriture, d’un trope déjà tout prêt et conservant l’homme comme protagoniste, les femmes réagissant dans un second temps à cette prise de pouvoir indue.
En « grattant le vernis », on découvre donc vite que peu de choses résident en dessous. Les aspects conservateurs de la famille nucléaire sont, eux, à peine dérangés et les personnages pourraient être des éléments narratifs interchangeables à l’infini.
Cas numéro 2 : Boulevard de la mort
C’est dans Boulevard de la mort (2007), production abordant les mêmes problématiques que Kill Bill – et voulue encore plus ouvertement féministe –, que ce qui restait de doutes quant à l’approche du cinéaste s’envole. Le film s’organise en un diptyque plus court que son prédécesseur et met en scène deux groupes de femmes. L’un est « purement féminin » en matière de clichés usuels : vêtements courts épousant les formes, sujets de conversation tournant autour de la mode, la beauté et les hommes, danses lascives, rien ne manque. Le second est beaucoup plus « femmes fortes » et investit de caractéristiques d’ordinaire prêtées au masculin. Il présente à l’écran des portraits davantage rattachés (pour deux d’entre elles) aux clichés de lesbiennes dites butch. Selon un principe de miroir inversé d’avec le premier, incluant des caractéristiques d’une certaine émancipation/intégration féministe, le second laisse ainsi Maxime Cervulle dans une profonde perplexité « devant le manque d’imagination […] de représenter des femmes puissantes comme des hommes comme les autres »4. Et d’ajouter que cela vient en lieu et place d’une extension de « la sphère conceptuelle du pouvoir pour le conjuguer au féminin »5 qui n’advient pas. Dans ce schéma, le masculin reste en définitive supérieur au féminin et le premier trio fait les frais de cette politique.
Émaillant ses dialogues de ce qui, dans sa tête, semble intéresse ou non les femmes féminines, Tarantino en ostracise la moitié sans état d’âme, puisqu’elles ne peuvent décemment pas aimer les « films de bagnoles ». En revanche, les deux femmes davantage masculines, elles, adorent. Elles aiment d’ailleurs les grosses cylindrées et le cinéma, mais aussi les armes, les jurons et la sexualité débridée toute en agressivité. Scène davantage marquante encore pour un film se voulant féministe : lorsqu’une des filles commence à être influencée par ses deux partenaires de route plus stéréotypées butch, et souhaite leur prouver qu’elle aussi est trop « cool ». Elle n’hésite pas, pour emprunter une voiture, à proposer la bonne blague de sous-entendre que la quatrième fille, endormie, est ouverte à toutes possibilités si le propriétaire de ladite voiture est tenté. Abandonner une des leurs à un potentiel viol parce que c’est apparemment « hilarant », rien de mieux pour montrer l’état d’esprit en place. Qui plus est, lors du tournage, une des actrices en désaccord avec cette scène a proposé une astuce de scénario bien plus cohérente d’un point de vue féministe (arnaquer l’homme toutes ensemble), solution refusée par un Tarantino a priori récalcitrant et peu ouvert aux propositions.
Encore une fois, derrière la revanche et la violence brute, il ne reste que peu de substance. Plus que des femmes fortes à part entière, les personnages deviennent des hommes forts camouflés sous des traits féminins. Ou plus exactement, l’idée que se fait un réalisateur se fiant à ses préjugés de ce qu’est une femme forte, complexe et moderne. Ce dernier est même surpris des protestations face à un film qu’il considère comme un réel « empowerment for women ».
Par ailleurs, et si ces groupes sont confrontés au même tueur en série – macho en puissance ayant pour extension phallique sa voiture –, il se verra mis à bas par le second uniquement. Mais outre la manière de filmer le premier trio tout en hypersexualisation, les comportements du second groupe ainsi que les plans, reproduisent à l’identique, eux, ce que pratiquait le méchant de l’histoire. Ces femmes se changent ainsi en ce qu’elles combattent, usent de la voiture, avec quelques répliques bien senties et complètent le tableau par une violence inédite.
Une question peut alors se poser, comme cela a souvent été le cas au sein des mouvements luttant pour l’égalité : quel féminisme ? Une mimique du masculin et de principes éthiques douteux teintés d’agressivité latente ? Ou une idée différente d’une humanité plus en accord avec des principes de non-oppression ? La violence jouissive du passage à tabac final fait peu de cas de ce type d’interrogations.
L’obstination d’un « bon » historien du cinéma
Il en va de même, comme le rappelle la chercheuse Célia Sauvage, pour Inglourious Basterds (2009) dans lequel la violence perd de son contexte pour quasiment se transformer en « une satisfaction sexuelle profonde de vouloir tuer des nazis », selon les termes d’Eli Roth, réalisateur de films de torture porn. Dans un mouvement proche de celui de Boulevard de la mort, c’est à travers un miroir déformant que les nazi-e-s, qui admiraient l’instant d’avant la violence à l’écran, se voient massacré-e-s par les juifs-ves dans le cinéma de Shoshana (Mélanie Laurent). Emboîtement et mise en abîme qui peuvent aussi être considérés comme magistraux si l’on y inclut les spectateurs-rices face à leur écran. Pourtant, cela reste tout de même problématique idéologiquement parlant quant à la violence et à ses implications.
Cette mécanique est déclinable à l’infini et Tarantino est devenu virtuose dans l’art de mettre en place des références cinématographiques autant que politiques tout en les décontextualisant. Il en vient à leur enlever systématiquement toute pertinence morale, sociale, politique ou temporelle au bénéfice du « fun » qu’il affirme rechercher à tout prix, interview après interview. Après tout, c’est vrai, à quoi bon se préoccuper de l’histoire, de la pertinence ou de la cohérence de ce que l’on utilise lorsque l’on parle d’esclavagisme, par exemple ? Il vaut mieux que cela « n’apparaisse qu’en toile de fond », selon ses propres termes. Il oublie certainement au passage les nombreux appels à penser sa pratique cinématographique et son éthique depuis le débat autour du travelling de Kapò (1959), notamment.
Dans Django Unchained (2012), la question du féminin est cette fois vite réglée par l’expression la plus basique du trope de la demoiselle en détresse. Par ce mécanisme même, il va à rebours de ses films précédents et illustre une nouvelle fois son manque de compréhension globale et profonde du féminisme. Le reste du film tient dans le parcours initiatique d’un afro-américain émancipé qui, en définitive, n’a plus d’afro-américain que la couleur de sa peau tellement chaque action devient discutable. De la monstration des corps à la violence de Django (Jamie Foxx), ou encore de son évolution psychologique à son leadership contestable, le « film sur l’esclavage que l’Amérique n’a jamais voulu faire » ressemble davantage au divertissement dont il n’aurait jamais dû hériter. Force est de reconnaître qu’un film ne peut tout prendre en considération, tout inclure, qu’il reste une fiction parfois légère et sans prétention. Mais les ambitions affirmées par Tarantino, ainsi que la matière même de ses films, sont une combinaison le contraignant immanquablement à honorer une certaine checklist. Faute de quoi, son action crée davantage de confusion que de progrès.
Annulant par ailleurs toute discussion critique au regard de l’ambivalence de sa position entre art et commercial, Tarantino use et abuse de l’argument massue de son usage décomplexé de tout et n’importe quoi, et ce au service d’une mécanique pensée pour plaire. Il effectue ainsi constamment, et à plus ou moins grande échelle, le même mouvement : omniprésent, il exprime ses goûts, pensées et affects personnels par le biais de tout ce qu’il juge bon d’utiliser. Et ce, sans aucun souci des origines et ramifications de chaque élément dans lequel il se taille un costume à grands coups de machette. Les femmes n’ont plus d’individualité ou d’histoire, pas plus que les personnes noires, les emprunts cinématographiques ne sont plus que de pales copies, la violence est vidée de tout appui autre que le plaisir cathartique des spectateurs. Tout et tou-te-s sont ramené-e-s aux circonvolutions du propre cerveau de Tarantino, et au plaisir qu’il prend et voudrait donner au travers d’exutoires n’ayant pour point d’intersection que sa propre personne. Par ailleurs, et au-delà d’une image publique travaillée, l’homme n’est pas connu pour porter les luttes que ses films prétendent faire avancer. Comme à l’occasion de cette photographie issue d’une série accordée au W Magazine pour assurer la promotion de Django Unchained et chacun-e sera laissé-e seul-e juge.
Cas d’école d’une industrie de la culture pensant avoir compris et digéré des féminismes « datés » à coup de cultural studies, Tarantino fait partie d’une mouvance bien plus compliquée à placer sous le spectre des oppressions. Et ce puisqu’elle entremêle éléments progressistes et traditionnels. Il n’en demeure pas moins que son ironie et sa désinvolture ne bénéficient pas, en définitive, à ses ambitions politiques demeurant à l’état de fantasmes confus. Ayant souligné lors d’interviews et démontré au travers de ses films sa fascination autant que sa peur des femmes, le réalisateur en fait autant des objets de contemplation que des hybrides stéréotypées.
S’il divise autant, c’est peut-être précisément du fait de son caractère figé – aussi effrayé qu’hypnotisé – d’observateur externe pensant saisir la manière de tout inclure dans une seule forme, en donnant la priorité à l’excitation et au divertissement. Fétichiste des apparences, il les manipule à la manière d’un peintre du dimanche, inapte à saisir les subtilités d’une touche impressionniste. Maxime Cervulle a cependant développé une théorie selon laquelle « les hommes hétérosexuels s’abandonnent à une soumission sexuelle, ou s’investissent affectivement dans des représentations de femmes puissantes et armées, comme des temps de loisirs où ils tentent de desserrer un instant l’emprise que le genre et la domination ont aussi sur eux »6. Loisir possible du fait des privilèges mêmes de ces hommes, mais alternative intéressante à un Tarantino qui se leurre probablement lui-même lorsqu’il pense remettre en cause le statu quo.
1 Le revenge est un sous-genre cinématographique, qui peut être affilié au cinéma d’exploitation, au cinéma d’horreur ou au thriller. Le scénario repose sur la vengeance de la victime ou de ses proches.
2 « L’ère des top girls : les jeunes femmes et le nouveau contrat sexuel » dans Figures du féminin dans les industries culturelles contemporaines, Angela McRobbie, Volume 28 numéro 1, 2009.
3 « Quentin Tarantino et le (post)féminisme. Politiques du genre dans Boulevard de la mort » dans Figures du féminin dans les industries culturelles contemporaines, Maxime Cervulle , Volume 28 numéro 1, 2009.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
Pour aller plus loin :
- Critiquer Quentin Tarantino est-il raisonnable ?, Célia Sauvage, Vrin, 2013.
- « Entretien avec Quentin Tarantino », Les Cahiers du Cinéma, 2009
- « Tarantino : Le guide ultime des choses à lire ou à voir avant Django Unchained », David Honnorat, Vodkaster, 2013.
- « Tarantino, ou l’émancipation par la violence », Anne Crémieux, Africultures, 2013.
- « Quelques réflexions sur Django Unchained », Camille Rougier, Le cinéma est politique, 2013.
- « Quentin Tarantino et les femmes », Carole Milleliri et Quentin Avene, critikat, 2013.