Entre fiction et autobiographie, La Cloche de détresse (1963), le premier roman de Sylvia Plath, évoque avec un humour aussi surprenant qu’efficace des sujets très sérieux. L’écrivaine y parle notamment de dépression, du sentiment d’abandon et de solitude lié à la détresse psychologique, ainsi que du quotidien des femmes aux États-Unis dans les années 1950. Chronique.
La Cloche de détresse (The Bell Jar, en anglais), c’est l’histoire d’Esther, une jeune étudiante de Boston, qui se voit offrir une bourse d’excellence et part faire un stage à New York pour un grand magazine de mode. La vie qu’elle découvre alors est bien loin de l’idée qu’elle s’en faisait : elle s’ennuie, ne cesse de réfléchir, de s’interroger et de se tourmenter au milieu des cocktails, des soirées mondaines et des rendez-vous galants. En décalage par rapport aux autres jeunes filles de la pension où elle réside, Esther semble beaucoup moins légère et insouciante, traînant avec elle le poids d’une intelligence et d’une sensibilité hors du commun.
Au fil des pages, le roman de Plath devient un lieu de questionnement autour des relations qu’entretiennent les femmes entre elles. L’écrivaine évoque notamment celle, conflictuelle, de l’héroïne avec sa mère, mais aussi sa vie dans un lycée pour filles en pension complète. Elle y raconte ensuite son enfermement aux côtés de femmes dans l’institution psychiatrique Belsize où elle se retrouve après une tentative de suicide. Esther observe d’un œil attentif le monde qui l’entoure, elle étudie les patientes et leurs symptômes, peu convaincue d’y être à sa place. « Je suis une observatrice¹ », déclare-t-elle. Peu importe où elle se trouve, elle ne peut s’empêcher de se sentir à part, différente de celles et ceux qu’elle côtoie.
La cloche de détresse, c’est ainsi cette nausée permanente qui ne nous quitte jamais vraiment, qui ne fait que nous donner un répit plus ou moins durable. Esther imagine que toutes les pensionnaires de l’hôpital se trouvent enfermées sous leur propre cloche, prisonnières comme elle de l’aliénation de leur esprit, de leur non-conformité, prisonnières à l’intérieur d’elles-mêmes. La jeune femme ne pense à aucun moment pouvoir totalement se défaire de l’emprise de cette cloche, estimant que même si elle y parvient, elle sera toujours susceptible de retomber dans ses travers. La cloche de détresse menace à tout instant de l’enfermer à nouveau : « Comment pouvais-je être sûre qu’un jour – au lycée, en Europe, quelque part, n’importe où – la cloche de détresse, accompagnée de ses déformations étouffantes, ne redescendrait pas sur moi ?² » Mais l’hôpital n’est pas seulement un lieu d’aliénation et d’enfermement où Esther se trouve privée de toute liberté. C’est une cage dorée, un havre de paix dont elle désire ardemment sortir, mais qui la protège du monde extérieur qu’elle redoute tant. L’étudiante y est littéralement sous cloche. Les lieux, à l’image de son esprit et de son imagination, sont pour elle autant un refuge qu’une prison.
En ouvrant au public l’espace privé de Belsize, Sylvia Plath entend aussi et surtout dénoncer les méthodes des années 1950 en institution psychiatrique. Elle décrit le quotidien de femmes enfermées avant tout pour « inadaptation sociale », catégorisées comme « hystériques » dès qu’elles cessent d’agir conformément à ce qu’attend la société, et subissant des abus de la part du corps médical. Les violences qu’elles endurent sont en effet omniprésentes dans l’ouvrage : violence symbolique, physique, verbale ; violence patriarcale systémique, intériorisée… Esther est très lucide concernant la position de ses pairs dans la société et en particulier au sein du ménage. Cependant, son envie de fonder une famille persiste, venant se heurter à son désir profond d’être un jour reconnue en tant qu’autrice. Cela reflète parfaitement les angoisses et dilemmes auxquels a pu être confrontée Sylvia Plath elle-même à cette époque. Autrice et héroïne du roman sont l’une comme l’autre autant horrifiées par l’idée de ne pas pouvoir avoir de carrière à cause d’une potentielle famille, que par celle de ne pas pouvoir avoir de famille à cause d’une carrière.
La cloche de détresse, c’est donc cette bulle de solitude qui entoure Esther. C’est aussi ce brouillard dont elle ne parvient pas à sortir ; ce sont ces idées noires, cette souffrance qui l’assaille. C’est son sentiment d’être piégée à la fois dans son esprit et dans la toile du devoir où tout le monde autour d’elle semble voué à s’engluer : mères, épouses, enfants, étudiant-e-s, patient-e-s… Esther se sent à l’étroit dans une vie qui ne lui convient pas et dont elle paraît destinée à demeurer simple spectatrice. Sylvia Plath nous fait ainsi pénétrer dans l’esprit d’un personnage en constante introspection, qui lutte à chaque instant pour ne pas sombrer. Mais l’héroïne finit par laisser la douleur et les idées morbides s’insinuer progressivement en elle, à travers un mal-être que l’on devine de plus en plus profond. Nous sommes plongé-e-s avec elle au cœur de cette spirale infernale dont on ne peut sortir et qui finit par ressembler à un véritable cauchemar : « Pour celui ou celle qui se trouve sous la cloche de détresse […], c’est le monde lui-même qui est un mauvais rêve.³ » Au travers de la cloche, la vie paraît distordue, irréelle et abstraite, rien ne semble à sa place.
Pour toutes ces raisons, La Cloche de détresse résonne toujours aussi fort en nous, et demeure une référence pour les critiques, un modèle du genre et un monument pour les autrices contemporaines. L’héritage de Sylvia Plath est intact dans le monde de la littérature comme dans la sphère féministe, son ouvrage constituant un puissant outil de réflexion à l’égard de comportements abusifs qui perdurent. La Cloche de détresse n’est pas seulement le cri de désespoir d’une femme en proie à la détresse psychologique, c’est un élan, une fin ouverte.
Au terme du roman, l’avenir d’Esther est incertain : parviendra-t-elle à quitter l’hôpital, à se défaire de la pression qui pèse sur elle et à se réconcilier avec elle-même ? Aura-t-elle l’occasion de faire de sa vie un rêve agréable ? De même, parviendrons-nous à vaincre les injonctions et contraintes qui nous accablent, exigeant toujours plus de volonté et de résilience de notre part ? Le roman ne répond pas clairement à ces questions, mais il nous insuffle juste assez d’espoir pour continuer notre combat en nous rappelant, s’il le fallait, son absolue nécessité.
¹« “I am an observer”, I told myself », p. 252.
² « How did I know that someday — at college, in Europe, somewhere, anywhere — the bell jar, with its stifling distortions, wouldn’t descend again? », p. 553
³ « To the person in the bell jar […], the world itself is the bad dream. », p. 544.
Image : Sylvia Plath. © Bettmann Archive / Getty
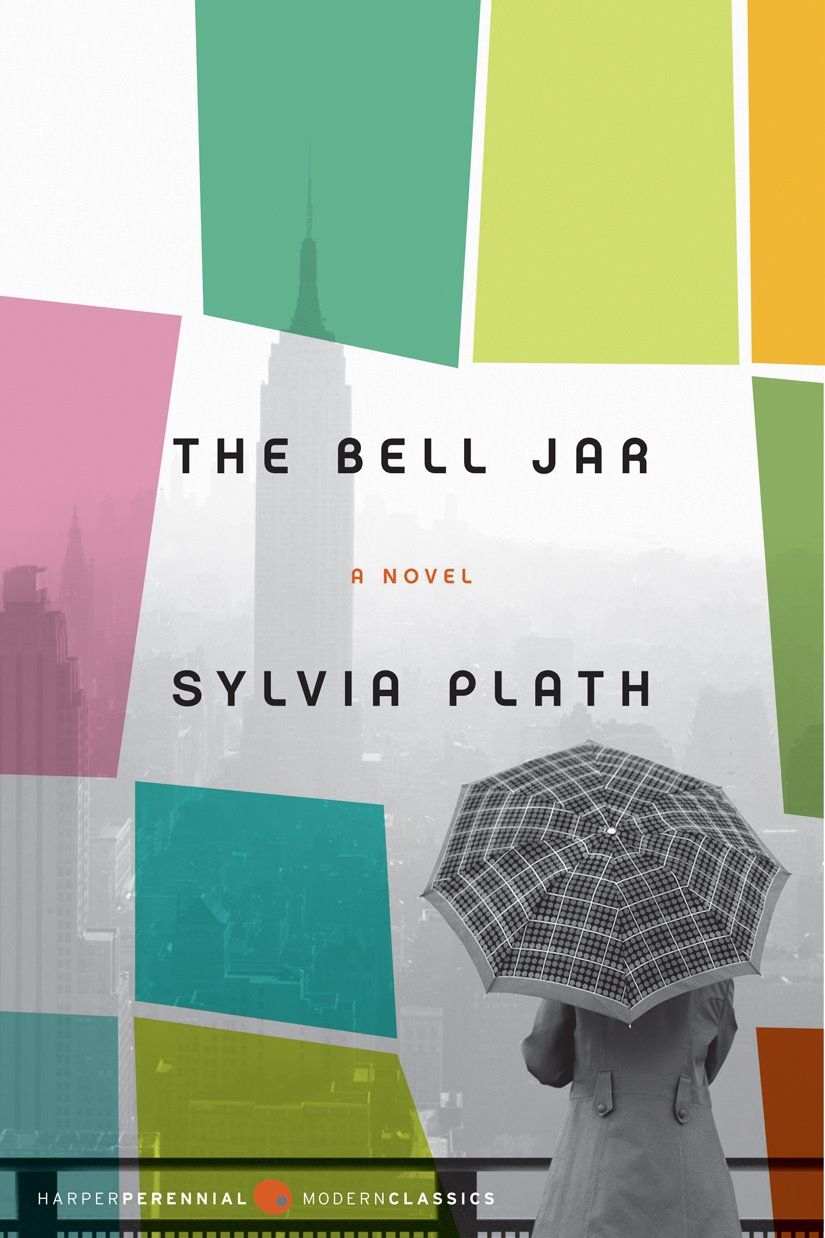 The Bell Jar
The Bell Jar HarperCollins
2013
288
Sylvia Plath
14,18 €
Esther Greenwood is brilliant, beautiful, enormously talented, and successful, but slowly going under—maybe for the last time. In her acclaimed and enduring masterwork, Sylvia Plath brilliantly draws the reader into Esther's breakdown with such intensity that her insanity becomes palpably real, even rational—as accessible an experience as going to the movies. A deep penetration into the darkest and most harrowing corners of the human psyche, The Bell Jar is an extraordinary accomplishment and a haunting American classic.


