La techno aurait-elle oublié son histoire ? Dans La Techno minimale de Mathieu Guillien, ouvrage fourmillant d’informations et explorant diverses directions – de la dub techno de Basic Channel aux compositeurs minimalistes de l’après-guerre – le spécialiste des musiques électroniques revient sur les origines de celles-ci. Entre perte d’identité, changements permanents et industrialisation à grande échelle, le pianiste et docteur en musicologie nous rappelle la nécessité de retracer l’évolution de cette musique, sans oublier d’en dénoncer les dérives racistes.
La techno a sa part de mythologie et de figures légendaires ; son âge d’or, ses révolutions et ses multiples influences culturelles. Trois décennies de recherche sonore que l’on pourrait aussi bien éclairer à la lumière des avancées technologiques – l’essor du numérique par exemple –, que par son itinéraire géographique à travers Detroit ou Londres. Son histoire est riche, comme celle de tant d’autres genres musicaux. Mais si ses cousins semblent avoir réussi à construire un récit sur plusieurs décennies, offrant un imaginaire commun et cohérent, la techno rencontre pour sa part plus de difficultés. Des mémoires savoureuses de Laurent Garnier compilées dans Électrochoc à l’indispensable documentaire Universal Techno réalisé par Dominique Deluze en 1996, les œuvres revenant sur l’essence du genre ne manquent pas. Pourtant, l’impact de ces analyses journalistiques et universitaires se traduit par un écho tout relatif. Si bien que ses véritables origines et la place des premiers compositeurs noirs de Detroit dans son histoire sont par exemple très rapidement esquivées.
C’est également le constat de l’ouvrage très complet La Techno minimale de Mathieu Guillien, docteur en musicologie tombé dans la marmite électronique lors de ses plus jeunes années. Car entre les années 1990 et aujourd’hui, l’image de la techno n’a guère changé. Elle souffre toujours des mêmes préjugés indélébiles et débiles qui lui collent à la peau. Parmi les poncifs maintes fois clamés par ses détracteurs et détractrices, on trouve la prise de drogues, la pauvreté supposée des productions techno ou de l’incompréhension des auditeurs-trices envers sa répétitivité. Il est ainsi très rare d’apercevoir des artistes de musique électronique sur les plateaux TV ou dans les médias de masse en général.
C’était mieux avant
« La techno n’occupe pas encore dans l’imaginaire collectif la place qui lui revient, mais un certain nombre d’ouvrages historiques de qualité sont désormais disponibles et ne pas savoir qu’il s’agit d’une musique noire américaine relève davantage du pur désintérêt que du complot médiatique », jauge le chercheur depuis son introduction. Ce n’est pas du goût non plus des pères fondateurs et d’autres artistes qui montent désormais au front.
C’est décidé, les valeurs d’origine de la techno made in Detroit ne doivent pas se dissiper dans l’oubli. Activiste sur le devant la scène, Carl Craig, DJ et producteur de la deuxième génération de musicien-ne-s de la « Motor City » dans les années 1990 a lancé son concept de soirées Detroit Love en 2004. L’objectif ? Inviter les légendes qui ont marqué l’évolution de cette musique industrielle à se produire sur scène aux quatre coins du globe. Se sont succédés à travers des line-up à faire rougir n’importe quel promoteur : Robert Hood, Kenny Larkin, Kevin Saunderson, Stacey Pullen et bien sûr le résident Carl Craig lui-même. Ce faisant, il ne cesse d’accueillir de plus jeunes artistes fidèles au son de Detroit, mais qui ne rechignent pas à en repousser les limites. Seth Troxler, Kyle Hall et Lee Curtiss ont déjà participé à cette grande messe.
Il est évident que Detroit et la communauté afro-américaine ont joué un rôle indispensable dans l’émergence du mouvement. Detroit, agglomération industrielle par excellence située dans l’État du Michigan, est devenue au début du XXe siècle le centre névralgique des productions d’automobiles à la chaîne du pays. Elle offre dans la première moitié du siècle dernier et dans les années qui suivent l’après-guerre une période de prospérité économique soutenue par les trois grandes firmes Ford, General Motors et Chrysler. Mais ce tableau a priori favorable ne doit pas éluder les tensions raciales que la ville a connues, marquées par de violentes émeutes notamment en juillet 1963. Puis, la cité entame dans la deuxième moitié du siècle un long déclin industriel laissant une part importante de la population sans emploi. Les populations afro-américaines sont massivement touchées. Conséquence de la fermeture des usines, la « Motor City » perd également ses habitant-e-s dans l’obligation de déménager à la recherche d’un avenir meilleur.
Le soulèvement des machines
Ces visions de friches industrielles au glorieux passé, baignées dans le smog nord-américain, deviennent l’image de référence de la techno. S’il n’en constitue pas sa seule influence, l’environnement de la cité a grandement contribué à dessiner l’esthétique musicale. D’après Mathieu Guillien : « Derrick May [ndlr, l’un des principaux pionniers, connu pour avoir composé Strings of Life] est le premier architecte de ce parallèle romantique lorsqu’il établit une continuité déterministe entre le passé industriel de Detroit et les machines de la musique électronique. »
« L’idée des machines, de l’électronique, est évidente. Surtout venant de Detroit. Ici, tout le monde a un membre de sa famille qui travaille dans l’industrie. C’est une influence directe, très froide, dénuée d’émotion. […] Cet environnement nous a créés. Et nous, à notre tour, socialement et inconsciemment, on a créé notre musique. En créant cette musique, on a recréé notre environnement. » – Derrick May, cité par Mathieu Guillien dans La Techno minimale (2014).
C’est pourquoi l’univers des hommes robots de Kraftwerk a si profondément influencé la clique des quatre pionniers que sont Derrick May, Juan Atkins, Kevin Saunderson et Eddie Fowlkes. Entre Kraftwerk, groupe de synthpop formé en 1970 à Düsseldorf et la bande nord-américaine on trouve la même obsession pour l’idée du futur et la fascination pour le bidouillage technologique.
Quand les artistes du Michigan ont entendu les premières notes d’Autobhan ou de The Robots – morceaux phares de Kraftwerk – résonner sur la radio locale, cela ne pouvait qu’attiser leur créativité. Leurs premières explorations à l’instar du répertoire de l’emblématique duo Cybotron sont teintées de fantasmes métalliques et avant-gardistes, dans la lignée de la New Wave teutonne. Projet à l’initiative de Richard Davis et Juan Atkins, Cybotron a « joué un rôle fondateur dans l’élaboration de l’imaginaire techno, en corrélant la science-fiction avec les nouveaux instruments électroniques littéralement inouïs », commente Matthieu Guillien. Les morceaux Clear ou Techno City sont autant d’hymnes à cette libération musicale.
Quand la dance music fait du Coldplay
La création de la techno est ressentie comme une démarche salutaire chez la première génération de producteurs. Les propos de Daniel Bell, essayiste et sociologue américain, viennent corroborer la thèse de Matthieu Guillien :
Lorsque l’industrie est sur le point de s’effondrer, il appartient aux futures victimes de ces crises d’utiliser la technologie pour échapper à ce qui les attend. Et c’est exactement ce qui est arrivé à Detroit, où l’industrie automobile s’est effondrée et où le temps s’est comme arrêté… La musique a été un moyen d’échapper à cette période et à cet environnement, un moyen de leur donner un sens.
Dès lors, le manque de considération actuelle pour les fondateurs afro-américains fait mauvais genre. À l’heure où les festivals d’EDM (electronic dance music, ndlr) rassemblent des dizaines de milliers de spectateurs et spectatrices devant David Guetta ou Tiesto, brassant des cachets faramineux pour quelques minutes de set, l’actualisation des fondamentaux de la musique électronique est une nécessité. Juan Atkins s’en est même pris récemment à un site internet, The DJ List. Dans un post Facebook, il accuse ce classement principalement composé de DJs à la sauce électronique mainstream de racisme. Son reproche : ne sélectionner que deux artistes noirs, situés à la 99e et la 100e place. Dans ce message à l’attention de sa centaine de milliers de fans, la moitié de Cybotron explique :
C’est une gifle pour tou-te-s les Noir-e-s. Allez, les mecs, on est en 2016, le racisme n’a pas sa place dans la culture électronique […] Tout le monde sait que les DJs noir-e-s sont parmi les meilleur-e-s et largement responsables du développement de la dance musique et de la culture DJ.
Où est passé mon argent ?
Bien que cette liste soit dévolue au versant le plus commercial et démesuré de la dance music, Juan Atkins refuse de la sous-estimer. Les médias spécialisés dans ce genre ont en réalité un impact non négligeable sur l’industrie musicale comme le booking des artistes. Et quand un internaute repris par Télérama range The DJ List au rang de vulgaire top EDM, Juan Atkins répond : « Tu peux dire ce que tu veux, sourire de tous ces DJ’s dits “commerciaux” qui n’auraient rien à voir avec la vraie techno. La vérité est qu’ils font du pognon sur notre dos, en utilisant notre histoire. »
Ce n’est pas la première fois que l’Américain exprime cette opinion. Dans un paragraphe à propos de l’amertume des défricheurs vis-à-vis de la commercialisation de cette musique, Mathieu Guillien poursuit cette analyse :
Il est donc primordial de distinguer le succès rencontré par la « techno » dans la plupart des pays industrialisés du sort des créateurs du genre qui à l’exemple de Juan Atkins [ndlr, dont les propos sont issus d’une interview dans l’émission Tracks le 7 mars 2008 sur Arte] s’interrogent : « La techno est devenue une grosse industrie ? Si vous le dites… Mais dans ce cas, où est passé mon argent ? ».
La « commercialisation outrancière selon le mot du musicologue » est à mettre néanmoins en relief avec une scène électronique rafraîchissante. C’est « cette substance qui appartient à une histoire qu’il s’agit au contraire de préserver », avance-t-il. Ballottée par les stéréotypes ou une industrie musicale friande de transformer les DJ-sets en spectacles de stade de foot, la techno perdure et aime rappeler son aspect underground. Mot galvaudé qui ne veut pas dire grand-chose à l’heure du partage en un clic.
Néanmoins la nouvelle génération de producteurs et productrices, de DJs et un public neuf reprennent avec ardeur les codes de la culture club originelle. De Jeff Mills à Derrick May, les pères fondateurs de la techno sont aujourd’hui à l’affiche de festivals et de clubs à la recherche d’une authenticité réactualisée. Et ce ne sont pas les soirées parisiennes, que l’on n’a jamais vues aussi audacieuses et florissantes, qui diront le contraire.
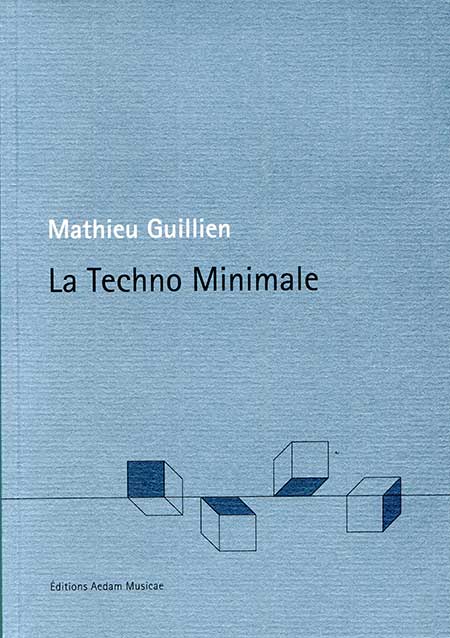 La Techno minimale
La Techno minimale
Mathieu Guillien
Maison d’édition : Aedam Musicae
Date de parution : Janvier 2014
Nombre de pages : 272
Prix : 22,00 €
- The 10 best Detroit techno documentaries ever, par Ken Taylor, Beatport, 22 octobre 2012
- Detroit techno and the genepool of jungle, par Joe Roberts, Vice i-D, 14 juillet 2015
- La techno est-elle encore la musique du futur ? par Sophia Salhi, Trax Mag, 4 janvier 2016






