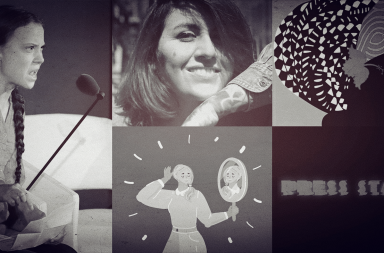Une chanson qui reste dans la tête, des errances littéraires et quelques réflexions : un Mémorandom introspectif, entre résilience féministe et intimiste. Aujourd’hui, Annabelle te parle de ses héroïnes, de ses compagnonnes de route, de celles qui lui ont permis d’avancer, jour après jour.
J’ai une chanson coincée dans la tête.
I’m every woman, it’s all in me.
Dans ce morceau, Whitney Houston ne chantait pas sur les femmes et la possible universalité de leur expérience. Ses préoccupations concernaient plutôt les différents moyens qu’elle avait à sa disposition pour satisfaire son partenaire. Mais cette phrase me hante. C’est une crise existentielle permanente. Comme quoi, sortie de son contexte, une citation peut prendre n’importe quel sens.
Je n’ai jamais aimé le jeu d’identification auquel la culture nous soumet au quotidien. Déjà, enfant, ces injonctions à être me semblaient injustes, tels des boulets attachés à mes pieds destinés à ralentir chacun de mes pas : « T’es un garçon manqué », « Tu es une si jolie jeune fille, pourquoi te couper les cheveux ? », « Tu fais comme les garçons », « Un jour, toi aussi, tu voudras un bébé, tu es une femme »… Ces petites sentences, dites avec bienveillance maintes fois, ont peu à peu réussi à défaire mes certitudes et mon innocence. Je n’étais pas plus féminine que masculine, davantage ceci que cela. J’essayais simplement d’exister aux yeux des autres avec les cartes que l’on m’avait données au début de la partie. Je tentais, en vain, d’être moi. Il m’aura fallu de longues années pour comprendre à quel point mon identité publique dépassait ma volonté, pour que j’arrête d’essayer de m’extirper des jugements permanents.
Gamine, j’incarnais ce que les autres voyaient pour moi. Pourtant, il y avait toujours en mon for intérieur une voix qui ne cessait de s’exprimer. Maladroitement, souvent. Avec sincérité, tout le temps. Mais elle cherchait constamment un-e destinataire, comme perdue dans un trou noir, dans une dimension parallèle dédiée aux déclassé-e-s de la société. Puis, j’ai lu d’autres femmes. Des femmes qui s’adressaient directement à cette voix, dont le chant n’avait aucun repos. Elles me parlaient. Dans les livres, dans les films, dans les chansons. Elles peuplaient mon imaginaire et ma réalité, bien au chaud dans mon lecteur CD ou dans mon sac de lycéenne. J’ai appris à aimer avec Billie Holiday, à me révolter avec Virginie Despentes, à chanter avec les Destiny’s Child, à rêver avec J. K. Rowling.
Plus tard, j’ai appris à résister avec Ursula K. Le Guin, à penser avec Naomi Klein, à disserter avec Emily Nussbaum, à lutter avec Angela Davis, Virginia Woolf, Audre Lorde et Simone de Beauvoir. J’ai trouvé du réconfort dans les femmes oubliées du XIXe siècle, lu et relu leurs vers, dont le génie déserte encore nos bibliothèques. J’ai eu le privilège de dévorer les poésies de Sara Teasdale, Voltairine de Cleyre, Karoline von Günderode, Christina Rossetti, Emily Brontë ou Emily Dickinson. Si les grands monuments, qui sont tels de majestueux tombeaux à la gloire de notre passé, les ont omises, pour moi, elles sont le souffle de la vie elle-même. De ma vie.
Un jour comme un autre, alors que j’errais dans une librairie à la recherche d’une nouvelle compagnonne de route, je suis tombée sur un poème de nayyirah waheed. Il y avait en ses quelques lexies les réponses à plus de deux décennies de questionnements personnels. De tentatives échouées pour formuler mon grand mal du siècle à moi :
all the women.
in me.
are tired.
« toutes les femmes. en moi. sont fatiguées. » Le pouvoir de ces vers m’a percutée comme une révélation philosophique, quasi spirituelle. Toutes ces voix qui m’habitaient depuis tant d’années étaient hors d’haleine à force de rebondir contre les murs de l’indifférence environnante. Auraient-elles un écho ? Qui nous répondra ?
Mes interrogations sont longtemps restées sans réponse, mais je ne suis pas décidée à m’arrêter de chercher. Les voix des femmes, de tou-te-s les opprimé-e-s résonnent ici, et là aussi. Partout. Ce sont des appels à la résilience, des chants d’espoir et d’empathie. Dans Trois guinées, Virginia Woolf a écrit : « Car, dira l’étrangère, en tant que femme, je n’ai pas de pays. En tant que femme, je ne désire aucun pays. Mon pays à moi, femme, c’est le monde entier. » Le terme original pour « étrangère » est « outsider ». Soit une personne qui ne trouve pas sa place dans une communauté, un groupe, et ici, un pays. Il y a à mes yeux beaucoup de justesse dans les mots de Woolf. Je n’ai jamais ressenti un attachement prégnant à mon pays, mais j’ai très tôt compris ce qu’être une femme signifiait, mon appartenance à toutes ces communautés de personnes, mon sentiment de reconnaissance pour celles qui ont livré bataille avant moi, résisté avant moi. Pour toutes celles qui ont dit et crié haut et fort qu’une personne ne peut être libre qu’à condition que nous le soyons tou-te-s.
Il y a une force singulière résidant dans le fait de se construire dans l’adversité. Les femmes, si multiples, différentes, si éclectiques et complexes, ont dû et doivent encore se battre contre un même ennemi aux différents visages, qu’il revêt comme autant de masques dissimulant sa duplicité. Dans toute son imperfection, sa diversité et sa puissance, la lutte des femmes à travers le temps et les frontières nous rappelle qu’ensemble, nous sommes redoutables. Nous sommes la résistance et la révolution. Nous sommes l’espoir que d’autres tentent inlassablement de nous ôter.
Œuvres citées (entre autres) :
- I’m Every Woman, « Bodyguard », Whitney Houston, 1992
- Trois guinées, Virginia Woolf, 1977
- I’m a Fool to Want You, « Lady in Satin », Billie Holiday, 1958
- D’espoir et de raison : Écrits d’une insoumise, Voltairine de Cleyre, 2008
- salt., nayyirah waheed, 2013